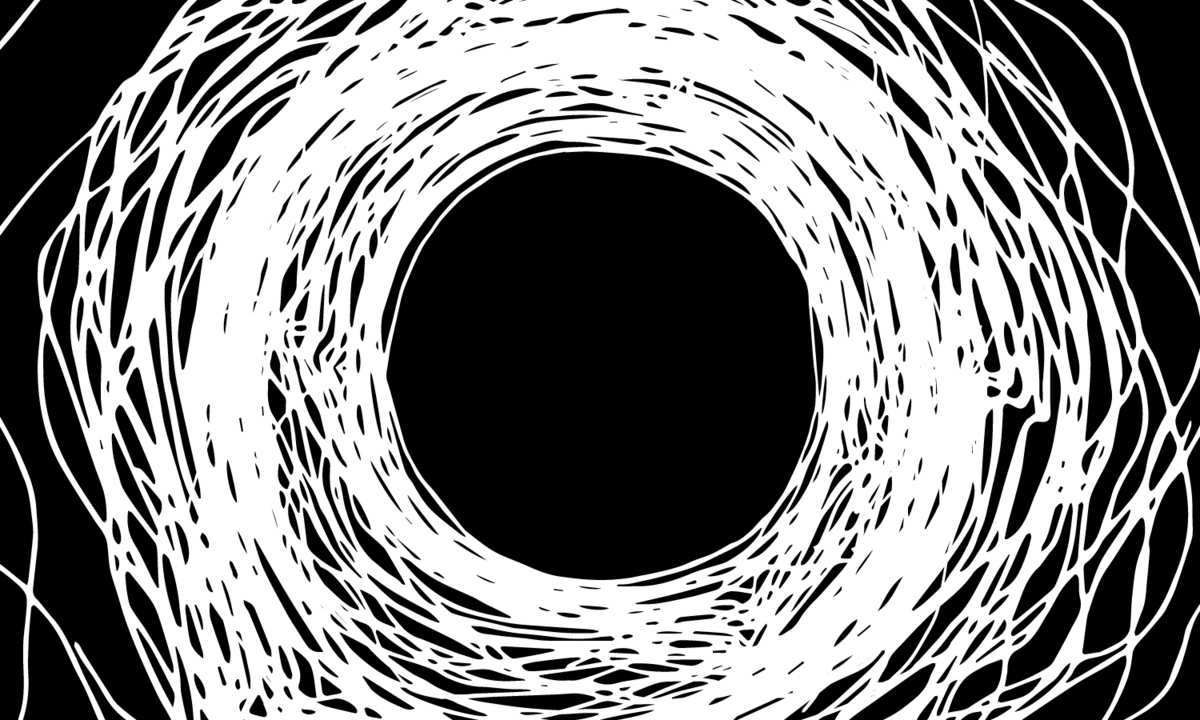Le 24 avril 2018
Le délit consistant à ne pas donner le code de déverrouillage de son téléphone aux enquêteurs lors d’une procédure pénale est conforme à la Constitution, selon le Conseil constitutionnel.
L’obligation de donner le code de déverrouillage de son téléphone aux enquêteurs validée par le Conseil constitutionnel.
Le délit consistant à ne pas donner le code de déverrouillage de son téléphone aux enquêteurs lors d’une procédure pénale est conforme à la Constitution, selon le Conseil constitutionnel.
Par une décision d’importance [1], le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnel et sans réserve d’interprétation le délit de refus de remise d’une convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Créé par la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et prévu à l’article 434-15-2 du Code pénal, ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270.000 euros d’amende.
Ce délit est défini comme « le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450.000 € d’amende si « le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450.000 € d’amende. »
Malgré les griefs contre ces dispositions soumises au Conseil constitutionnel, ce dernier décide néanmoins de donner un blanc-seing aux services de police concernant les téléphones portables des personnes qu’ils suspectent.
Ils pourront ainsi forcer, avec l’accord formel du Parquet, les individus faisant l’objet d’une enquête à fournir le code de déverrouillage de leur téléphone et leur laisser accéder à toutes leurs données personnelles, même si celles-ci se trouvent être sans rapport avec l’enquête.
Si la constitutionnalité de l’article n’était pas en elle-même remise en cause par le requérant, c’est bien son interprétation qui posait problème.
En effet, dans l’affaire à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la personne contrôlée par les policiers avait été trouvée en possession de produits stupéfiants.
Interpellée et placée en garde à vue, elle refusait alors de donner le code de déverrouillage de son téléphone motivant sa poursuite par le ministère public sur le fondement de l’article querellé.
La décision du Conseil constitutionnel est surprenante à bien des égards.
En premier lieu, elle dépasse les observations du représentant du Premier ministre, qui avait sollicité une réserve d’interprétation de cette disposition en excluant son application à la personne suspectée. De plus elle surpasse également les intentions du législateur, puisque selon les débats parlementaires ayant mené à l’adoption de cette disposition, cet article visait à ne punir que les tiers (créateurs de clé de cryptage, fournisseurs d’accès mobile,…) et non les personnes faisant l’objet d’une enquête pénale.
En second lieu, elle porte atteinte à certains droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution et notamment le droit au silence, le droit de ne pas s’auto-incriminer, ou encore le droit au respect de la vie privée.
La motivation de cette décision largement attentatoire aux libertés (I) risque d’être à l’origine d’un nombre important de dérives qui seront, on l’espère, encadrées par les juges et par la pratique. (II)
I – La motivation d’une décision attentatoire aux libertés.
Le requérant alléguait la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, protégeant le droit à une procédure juste et équitable, ainsi que l’article 9 protégeant la présomption d’innocence.
Ce dernier article a pour corollaire important le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Selon le requérant, le fait d’avoir été contraint de donner le code de son téléphone revenait à contribuer à sa propre incrimination et enfreignait donc son droit au silence.
Le Conseil constitutionnel balaie les arguments et décide, à travers cette décision, de faire prévaloir l’objectif à valeur constitutionnelle de répression des infractions pénales et de recherche de leurs auteurs.
D’abord, le Conseil constitutionnel entérine la volonté du législateur de ne pas forcer une personne à fournir le code de décryptage d’un appareil si elle ne le connait pas. Le contraire serait un comble.
Ensuite, il précise que l’enquête ou l’instruction « doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ».
En d’autres termes, seul un indice laissant apparaître que le téléphone du suspect a pu être utilisé pour préparer, commettre ou faciliter le délit permettra à l’enquêteur, d’obtenir le déverrouillage du téléphone.
En plus de laisser cette appréciation à l’agent, qui devient alors juge de sa propre procédure avec l’aval du Parquet, cette motivation, est particulièrement large.
En effet l’adjectif « susceptible » renferme un nombre infini de cas, a fortiori au regard de l’importance qu’ont pris aujourd’hui les téléphones portables dans notre vie quotidienne.
Il paraît d’ailleurs inconcevable d’imaginer qu’une personne suspectée de trafic ou d’usage de stupéfiants, de violences ou de meurtres, d’abus de biens sociaux ou bien encore de vol n’ait pas pu potentiellement utiliser son téléphone à un moment.
De plus il existe un risque non négligeable que les policiers trouvent des informations dans le téléphone autres que celles envisagées à l’origine, concernant soit une autre infraction, soit une autre personne.
Étant donné l’empressement de la chambre criminelle à valider les procédures incidentes, une pratique policière dangereuse de déverrouillage systématique des téléphones sur la foi de poussières d’indices, pourrait alors voir le jour.
Enfin, et c’est là le plus déroutant de tous les arguments des Sages, les données à décrypter sont « déjà fixées sur un support » et « existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée ». Ainsi, il n’y aurait pas d’auto-incrimination puisque les données… existent déjà.
Cette argumentation est particulièrement étonnante. En effet, quel serait alors l’intérêt d’accorder des garanties au moment d’une perquisition, les preuves et indices qui seraient découverts existant forcément déjà.
De même, les pensées d’une personne existent également sans qu’on lui impose pourtant de passer aux aveux. Cette motivation du Conseil constitutionnel n’est finalement que la résurgence de la culture de l’aveu, à travers la preuve numérique.
Il convient d’ailleurs de préciser que le téléphone mobile n’est finalement que le domicile virtuel d’une personne permettant tout à la fois de connaitre ses conversations les plus intimes, ses comptes bancaires, ses contacts, son orientation sexuelle, son état de santé.
Toutefois les garanties liées aux perquisitions ne s’appliquent pas ici. En effet la demande de code de déverrouillage peut intervenir sur simple demande des enquêteurs et la loi ne fait aucune distinction en fonction du propriétaire du téléphone.
Ainsi l’avocat et le médecin seront soumis au même régime que toutes personnes non soumises au secret professionnel.
II – Les risques inquiétants de dérives engendrés par cette décision.
Le Conseil constitutionnel a à de nombreuses reprises affirmé l’inconstitutionnalité de dispositions enfreignant de manière disproportionnée les droits et libertés fondamentaux au regard des objectifs poursuivis.
Ce n’est toutefois pas la voie choisie ici par le Conseil, qui a estimé que l’objectif de prévention et de répression des infractions justifiait l’atteinte à la présomption d’innocence et au droit à une procédure équitable de ces dispositions.
C’était pourtant ici l’occasion d’assortir sa déclaration de constitutionnalité d’une réserve d’interprétation en se référant aux travaux législatifs et à un précédent refus par les parlementaires de pénaliser le refus pour un suspect de donner lui-même le code de déverrouillage de son téléphone.
L’ atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer mais également à la vie privée semblent pourtant disproportionnées au regard du but poursuivi, d’autant que, jusque-là, certains services de police avaient recours à des experts afin de décrypter les données contenues sur des supports informatiques.
On peut d’ailleurs légitimement se poser la question de la nécessité de porter atteinte au droit de ne pas s’auto incriminer alors même que le recours à des experts pour « craquer » les téléphones demeure possible, sur simple réquisition d’un enquêteur ou d’un magistrat.
Il est à craindre que des logiques purement budgétaires soient à l’origine d’une atteinte importante à un droit constitutionnellement protégé.
Les services d’enquête auront désormais la faculté de la menace de poursuites en cas de refus de fournir le code de son téléphone par la personne suspectée (voire de son ordinateur ou de son coffre-fort), et n’en déplaise au Conseil constitutionnel, il s’agit bien ici d’enfreindre le droit au silence de chaque individu, et de dévoiler ses informations les plus privées.
De plus le Conseil constitutionnel reste étonnamment silencieux sur l’un des arguments pourtant soulevés par le requérant selon lequel le code d’un téléphone ne serait aucunement un moyen de cryptologie.
Cette question reste ainsi toujours en suspens et il reviendra à la chambre criminelle de se positionner sur cette question et de définir exactement ce qu’est un moyen de cryptologie au sens de la loi.
Ainsi un mot de passe d’un compte Facebook ou WhatsApp pourrait-il également être considéré comme un moyen de cryptologie ?
Bien d’autres questions et incohérences restent en suspens.
N’est-il pas disproportionné qu’aucune distinction ne soit faite selon les crimes et délits suspectés ? On peut ainsi relever que dans certains cas (usage de stupéfiants notamment) l’infraction principale la plus sévèrement réprimée deviendra le refus de transmettre le code de téléphone aux enquêteurs.
De plus en cas de déverrouillage forcé du téléphone par un expert, en raison du refus de donner le code aux enquêteurs, l’infraction demeurera-t-elle constituée ?
Cette infraction, lorsqu’elle sera poursuivie en concours avec un délit originel, se verra-t-elle appliquer le régime du concours réel d’infractions ou bien un cumul de peines existera-t-il ?
En effet pour des infractions de nature similaires supposant une volonté de se soustraire à l’autorité judiciaire, tel que le refus de se soumettre aux prélèvements ou bien encore l’évasion, les peines sont cumulées avec les infractions à l’origine de ces délits.
On ne peut qu’attendre avec une certaine hâte que ces questions et incohérences soient posées à la chambre criminelle de la Cour de cassation, voire à la Cour européenne des droits de l’homme.
Celle-ci n’en serait pas à tancer pour la première fois la procédure pénale française si elle devait constater l’inconventionnalité de ces dispositions.
Xavier-Alexandre HERNANDO, Avocat
Collaborateur du cabinet LESAGE Avocats
Matthieu Lesage, Avocat à la Cour


/image%2F1490620%2F20160113%2Fob_f72574_clap-blog.jpg)